C’est quoi un CDD ? Tout comprendre au contrat à durée déterminée
En France, différents types de contrats de travail sont proposés par les employeurs. Parmi eux : le CDD, ou contrat court, fait l’objet de règles très strictes.
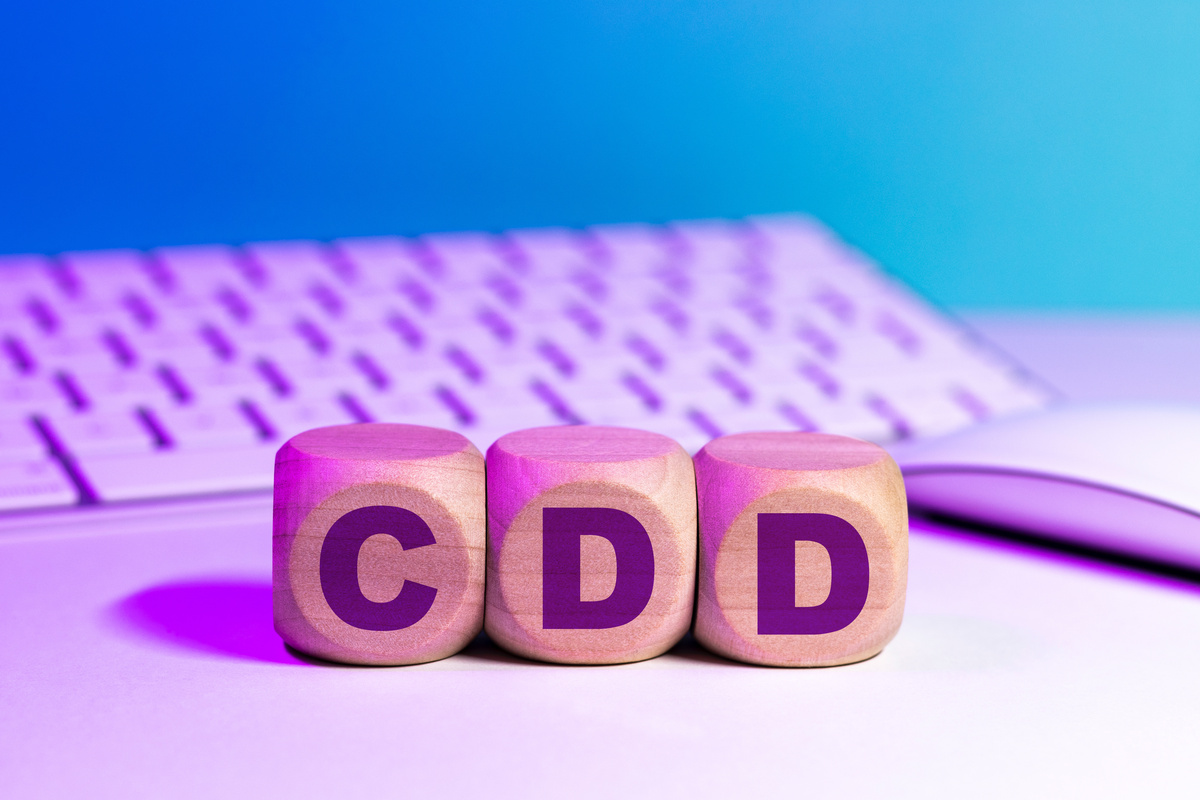
Sigle pour Contrat à Durée Déterminée, le CDD est un contrat destiné à prendre fin à une date donnée. Comme les autres types de contrats de travail (CDI, contrat d’apprentissage…), il est encadré par des règles précises régies par le Code du travail. Définition, durée maximale, prime de précarité, motifs de requalification en CDI : le guide complet sur le CDD pour les salariés.
Quelles conditions pour établir un contrat à durée déterminée ?
Un salarié qui conclut un CDD avec une entreprise est recruté pour une durée définie. D’après le Code du travail, l’employeur a le droit de recourir à ce type de contrat uniquement pour « l’exécution d’une tâche précise et temporaire » et dans les cas énumérés par la loi (articles L1242-2 et L1242-3).
Les situations autorisées sont :
- Le remplacement d’un salarié absent ou provisoirement à temps partiel (congé parental, maladie, accident, congé sabbatique, formation, etc.).
- Le remplacement d’un employé ayant quitté l’entreprise et dont le poste est amené à être supprimé.
- Le remplacement d’un salarié n'ayant pas encore pris ses fonctions.
- L’augmentation temporaire de l'activité commerciale de l’entreprise. Par exemple : une surcharge de travail liée à un projet urgent. Il s’agit d’un CDD d’usage.
- Des travaux saisonniers : les secteurs de l’industrie agricole ou du tourisme (stations de ski, hôtellerie…) sont typiquement concernés.
- Les « emplois aidés » tels que le contrat d’insertion professionnelle ou le contrat de professionnalisation.
De plus, la loi autorise certains secteurs à proposer des contrats CDD s’il est « d’usage constant » de ne pas recourir aux CDI de par la nature temporaire des emplois. C’est le cas par exemple de l’enseignement, de la restauration ou encore des activités d’enquête et de sondage. Retrouvez la liste complète des emplois autorisés.
En revanche, un contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à une activité normale et permanente de l’entreprise. Ces règles visent à éviter des dérives telles que le recours des CDD en guide de période d’essai. Selon la jurisprudence, une start-up ne peut proposer des contrats CDD pour ses premiers employés au motif d’une augmentation temporaire de l’activité. Une phase de démarrage ne constitue pas une activité temporaire, mais bien une « activité normale de l’entreprise ».
bon à savoir
Quelle est la durée maximale d’un CDD ?
Pour être conclu, un contrat à durée déterminée doit être obligatoirement écrit. L’employeur peut proposer :
- un terme précis avec une date de fin du contrat
- un terme imprécis, uniquement dans des cas tels que le remplacement pour congé maladie d’un employé. Une durée minimale de contrat doit alors être prévue, ainsi que le motif de sa conclusion (le retour du salarié par exemple).
Pour un contrat à durée déterminée conclu avec une date de fin précise, la durée maximale est de 18 mois, renouvellement inclus (article L.1242-8-1 du Code du travail). Il existe des exceptions comme le CDD dont la mission est effectuée à l’étranger (24 mois), le remplacement d’un salarié avant la suppression définitive de son poste (24 mois) et le CDD à objet défini (36 mois).
Un contrat à durée déterminée peut être renouvelé deux fois, sans dépasser les limites légales mentionnées précédemment. Le renouvellement doit être mentionné dans le contrat initial ou dans un avenant signé. L’objectif est d’éviter qu’il ne soit reconduit ad vitam aeternam. Si cette règle n’est pas respectée par l’employeur, le salarié a la possibilité de requalifier son CDD en CDI.
Enfin, la succession de deux contrats CDD est possible à condition de respecter un délai de carence. Sa durée est égale à 1/3 du contrat initial, ou la moitié pour les contrats de moins de 2 semaines. Seules exceptions : il n’existe pas de délai de carence en cas de remplacement d’un salarié ou si l’employé exerce dans un nouveau poste.
Dans quels cas le salarié peut-il requalifier un CDD en CDI ?
Selon le Code du travail, un contrat de CDD qui ne respecte pas certaines conditions peut être requalifié en CDI (art. L1245-1). Les cas sanctionnés sont les suivants :
- le CDD a été renouvelé plus de deux fois
- la durée du CDD dépasse le maximum légal
- le CDD n’a pas été établi par écrit
- le motif précis du recours au CDD n’est pas précisé dans le contrat
- le CDD concerne un poste permanent et non une tâche spécifique et temporaire
- le CDD remplace une personne suspendue suite à un conflit collectif de travail
- le CDD implique des travaux particulièrement dangereux
- aucune durée minimale n’est prévue dans le cas où le CDD vise à remplacer un salarié absent temporairement
- le contrat de CDD ne comporte pas les mentions obligatoires telles que le montant de la rémunération, la durée de la période d’essai ou la convention collective applicable
- la relation contractuelle entre l'employeur et le salarié perdure au-delà de la date de fin établie.
Pour obtenir la requalification d’un CDD en CDI, le salarié doit saisir le conseil de prud'hommes. Le délai de recours est de 2 ans à partir de la date de fin du contrat à durée déterminée. Dans certains cas, il peut également être indemnisé.
Rupture anticipée d’un CDD : c’est possible ?
En règle générale, la rupture d’un contrat à durée déterminée avant son terme est impossible. Il existe toutefois des cas particuliers encadrés par la loi. En effet, l’employeur peut exiger la résiliation anticipée du contrat de travail en cas de faute grave, de force majeure ou d’embauche en contrat à durée indéterminée du salarié. S’il décide de rompre le CDD en dehors de ces situations, il doit verser une indemnisation équivalente aux salaires restants dus.
Pour les salariés, une rupture du contrat avant son terme est possible lors d’une embauche en CDI. Elle peut également avoir lieu par consentement mutuel avec l’entreprise (rupture conventionnelle) ou en cas de force majeure.
Quels sont les droits des salariés en CDD ? Prime, salaire, congés
Bien qu’occupant un emploi de façon temporaire, le salarié en CDD possède plusieurs droits dans l’entreprise.
La prime de précarité
Le contrat à durée déterminée étant considéré comme un emploi précaire, le salarié perçoit une prime de précarité à la fin de son contrat (article L1243-8 du Code du travail). L’employeur est dispensé de son versement si :
- le salarié a commis une faute grave
- le contrat a fait l’objet d’une rupture anticipée
- le salarié refuse ou accepte un CDI proposé par l’employeur
- il s’agit d’un CDD saisonnier.
Le montant minimum de l’indemnité est égal à 10 % du salaire brut total versé au cours du CDD. Il est possible de l’estimer en utilisant le calculateur proposé par le gouvernement.
La rémunération
Le salaire d’un employé en CDD ne peut être inférieur à celui d’un employé en CDI avec un poste équivalent. De plus, il a le droit aux mêmes avantages tels que le 13e mois et les tickets-restaurant.
La protection sociale
Droit aux congés payés, mutuelle d’entreprise, droit aux indemnités chômage, compte personnel de formation (CPF), aides de Pôle Emploi… L’employé en CDD possède également les mêmes droits sociaux qu’un salarié en CDI.
- X
Sur la même thématique
Préparez-vous à
décrocher votre job !
155 000
CV lus en moyenne chaque jour, soyez le prochain à être vu !
soyez visible auprès des recruteurs
792 493
offres en ce moment, on vous envoie celles qui collent ?
soyez alerté rapidement
Toutes les offres d’emploi
- Paris
- Lyon
- Toulouse
- Marseille
- Nantes
- Bordeaux
- Rennes
- Strasbourg
- Lille
- Montpellier
- Nice
- Aix-en-Provence
- Reims
- Dijon
- Annecy
- Grenoble
- Tours
- Angers
- Metz
- Caen
{{title}}
{{message}}
{{linkLabel}}




