- Trouver mon job s
- Trouver mon entreprise s
-
Accès recruteur
- Diffuser ma première offre
- Déjà client
-
Emploi
- Formation
-
Mon compte
- Se connecter Mon compte
- S'inscrire
-
- Mon espace
- Mes CV vus
- Mes candidatures
- Mes alertes
- Mon profil
- Paramètres
- Déconnexion
Pourquoi l'open-space ?
Un petit historique s'impose.
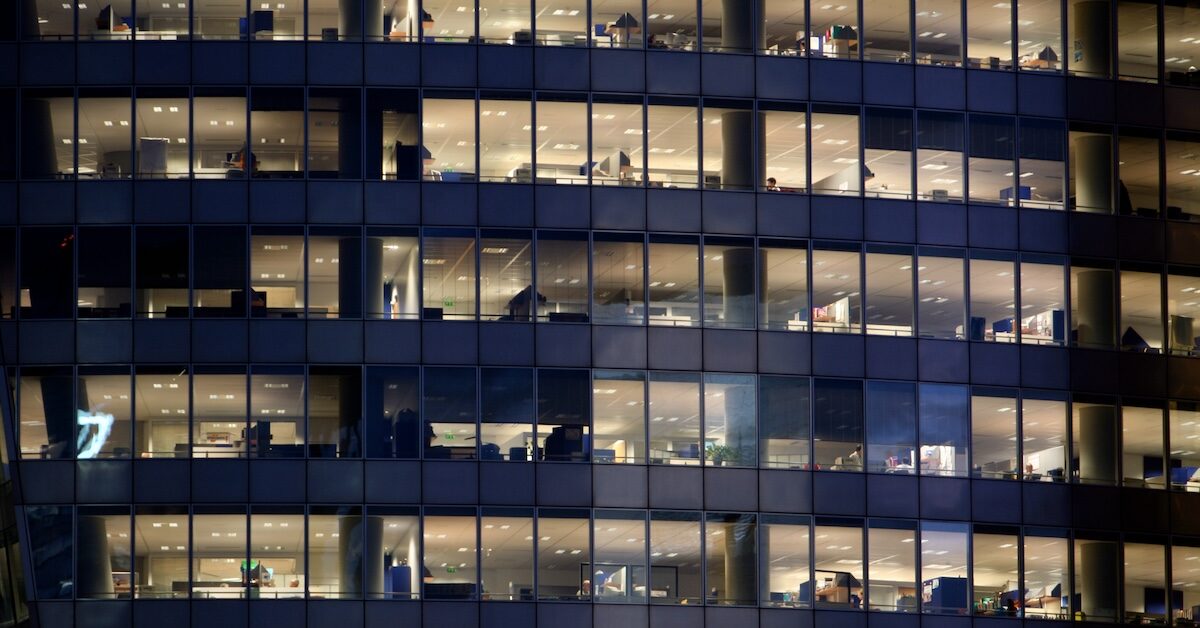
Si vous travaillez dans le tertiaire, il y a de grande chance pour que vous connaissiez le concept, et il est fort probable que votre bureau se situe dans l’un de ces bureaux paysagés (oui, c'est le terme français). Une définition s’impose tout de même : selon le Larousse, il s’agit d'une « grande pièce regroupant plusieurs postes de travail dans un même espace non cloisonné ».
Une chose est sûre : le bureau individuel est désormais synonyme de privilège, le plus souvent réservé aux dirigeants et aux chefs de services. Mais comment, et pourquoi l’a-t-on progressivement remplacé par l’open-space ? Petit historique de ce phénomène, révolution de la vie de bureau pour certains, symbole des dérives du management moderne pour d’autres.
Le Louvre, premier open-space ?
Selon Pascal Dibie, ethnologue et auteur de Ethnologie du bureau, il apparaît pour la première fois en France en 1860 après un incendie dans le ministère des Finances, alors installé au Louvre. On installe les fonctionnaires dans un grand espace commun... qui brûle à nouveau en 1871 sous la Commune ! Le ministère est alors reconstruit, mais renoue avec les bureaux individuels, à la demande des fonctionnaires qui n’ont visiblement pas goûté aux plaisirs de cette expérience inédite pour l'époque.
Après cette courte et anecdotique expérience, la France restera longtemps hermétique au concept d’open-space, et il faudra attendre les années 70 pour que les espaces de travail communs traversent l’Atlantique, et les années 2000 pour qu’on commence à parler d’open-space en Hexagone.
Les véritables pionniers
Vous l’aurez compris, c’est donc du côté des États-Unis qu’apparaît le phénomène : inspirés par l’organisation du travail en usine, les premiers bâtiments proposant des espaces de travail communs apparaissent au début du XXème dans les grandes villes de l’est (principalement Chicago et New York). On conçoit donc les premiers open-space dans un but d’optimisation : rapprocher les salariés d’un même service pour faire circuler plus vite l’information. Les employées (car ce sont bien souvent des femmes, notamment les dactylos) sont disposées par rangées de bureaux à l’image des successions de postes de travail sur les chaînes de production. Le chef de rang est placé sur une estrade, pour surveiller la cadence des travailleurs. Une première dans le secteur tertiaire !
Et puisque cette révolution des espaces de travail est étroitement liée à l’architecture, c’est le grand Frank Lloyd Wright qui conçoit ce que l’on considère souvent comme le premier open-space au monde : le Larkin Administration Building, construit en 1906 dans l’état de New York. Bâti pour une entreprise de savon, il consiste en un grand puits central éclairé par le haut, qui éclaire les pièces de chaque étage et une grande salle au milieu où travaillent les employés, sans aucune cloison. Lloyd Wright signera plus tard l’immeuble de la Johnson Wax dans le Wisconsin, qui est encore à ce jour considéré comme l’un des plus beaux open-space au monde.
Le bureau paysager à l’allemande et le cubicle
À mesure que le monde se « tertiarise », les espaces de travail se standardisent, et l’Europe se met elle aussi à entamer une réflexion sur l'organisation des espaces de bureau. Dans les années 50, les frères Schnelle imagine le concept de Bürolandschaft (« paysage de bureau » en français, d’où le terme cité en introduction). À la tête d’une entreprise d’aménagement d’espaces de travail, les deux allemands veulent rompre avec la structure rigide des couloirs et des bureaux, en proposant quelque chose de plus organique et naturel, avec l’utilisation de paravents courbés et de grandes plantes pour délimiter les espaces individuels.
Directement inspiré du Bürolandschaft, l'américain Robert Propst élabore en 1964 le premier système de cloisons modulables pour l'entreprise Herman Miller : chaque employé dispose d’une vingtaine de mètres carrés fermé par des paravents et d’un ensemble de mobiliers et de fournitures au design léché (qu’on retrouve d’ailleurs dans les bureaux de Sterling Cooper dans la série Mad Men).
Le cubicle, c'est -à -dire la cloison mobile inventée par Propst, est vite adoptée par les entreprises dans les années 70. Le but est que le salarié dispose d’un espace de travail individuel dans lequel il peut s’isoler, tout en ayant accès à l’espace collectif, sans avoir à se déplacer dans une autre pièce : il lui suffit de se lever ! Mais à mesure que les entreprises deviennent des cubicle farms (des « clapiers à lapins »), les employés dénoncent les dérives de leur pré-carré étouffant, peu propice à la communication entre collègues et de l’isolement que génère ces petites cabines (qui a notamment inspiré une cocasse scène de Playtime de Jacques Tati).
Peu avant sa mort, Probst lui-même se montrera amer sur son invention : « Toutes les organisations ne sont pas intelligentes et progressistes, beaucoup sont dirigées par des gens grossiers. Ils fabriquent des petites cabines minuscules et y entassent les gens. Des endroits vides, de vrais trous à rats. »
Plateaux, multi-space et flex-office
Exit, donc, les cabines individuelles. Les cubicles disparaissent peu à peu dans les années 80. À la place, les entreprises rassemblent progressivement les employés sur les « plateaux » sans cloisons. L’arrivée en masse de l’ordinateur dans les espaces de travail modifie profondément les habitudes des employés de bureau : sans remplacer complètement les échanges oraux, les emails et autres services de messagerie transforme radicalement la façon de communiquer entre collègues. L’informatique va également permettre aux collaborateurs de recréer eux-mêmes leur propre capsule, virtuelle cette fois, pour pallier les nuisances sonores, notamment via leurs écouteurs ou leur casque audio.
D’autres phénomènes vont contribuer à changer la conception de l’open-space à partir des années 2000. Parmi eux, le « hot-desking », que l'on connait en France sous le nom de flex office : se rendant compte que les employés ne passeraient en réalité que peu de temps à leur bureaux (congés, télétravail, déplacement, réunions, etc…), certaines entreprises décident de supprimer des postes en supprimant le bureau attitré. L'employé de bureau doit donc réserver sa place avant d’arriver, parfois via une application dédiée.
Enfin, il est désormais possible de se concentrer au sein d’un open-space : bienvenue dans le multi-space ! Derrière cet (énième) anglicisme, il s’agit de la mise à disposition d’autres espaces de travail que la grande salle commune : les collaborateurs peuvent aller passer leurs appels dans des box fermés ou s’offrir un moment de réflexion ou de concentration dans un pouf, loin de l’agitation des plateaux. Ce système est notamment en vigueur chez Sanofi, Danone ou l’Oréal.
À qui profite l’open-space ?
De l’expérience du Louvre à l’ère des cabines individuelles jusqu’à aujourd’hui, les salariés qui peuplent l’open-space n’ont eu de cesse de pointer ses limites : problème de concentration, interruptions trop fréquentes, surveillance permanente, déshumanisation, etc…
D’ailleurs, l’open-space permet-il vraiment au collaborateurs de communiquer plus facilement ? Pas vraiment selon des chercheurs d’Harvard, qui ont mesuré son impact sur ces échanges en 2018 : «Nos recherches montrent que les interactions en face-à-face diminuent significativement dans les bureaux ouverts : dans deux entreprises du Fortune 500, elles ont baissé de 70 % après la transition vers des espaces ouverts, tandis que les interactions numériques augmentaient pour compenser. »
L’entraide serait en revanche l’un des atouts de ce type d’organisation du travail. C’est en tout cas ce que démontre une étude de la DARES*, menée en 2023 : « Lorsque les salariés ont du mal à faire un travail délicat et compliqué, ils sont plus nombreux à recevoir de l’aide de leurs collègues (92% contre 86% (pour ceux qui travaillent en bureaux dits “classiques”, ndlr) ». A contrario, selon la même étude « leur travail est plus intense, plus contrôlé et offre moins d’autonomie, malgré des horaires moins étendus ».
Pour les entreprises, proposer l’open-space présente a minima deux avantages de taille. Le premier est l’économie de mètres carrés, et par conséquent une considérable économie sur l’immobilier : en 40 ans, la taille moyenne d'un poste de travail est passée de 25m² à 15m². Un gain non négligeable face à la montée en flèche du foncier. Deuxième atout : la flexibilité et l’adaptabilité de l’open-space, que l’on peut facilement reconfigurer en déplaçant simplement des mobiliers modulaires et en réorganisant les équipes sans travaux lourds ni coûts importants de réaménagement.
*Direction de l'Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques
- X
Sur la même thématique
Préparez-vous à
décrocher votre job !
155 000
CV lus en moyenne chaque jour, soyez le prochain à être vu !
soyez visible auprès des recruteurs
790 620
offres en ce moment, on vous envoie celles qui collent ?
soyez alerté rapidement
Toutes les offres d’emploi
- Paris
- Lyon
- Toulouse
- Marseille
- Nantes
- Bordeaux
- Rennes
- Strasbourg
- Lille
- Montpellier
- Nice
- Aix-en-Provence
- Reims
- Dijon
- Grenoble
- Annecy
- Tours
- Caen
- Angers
- Clermont-Ferrand
{{title}}
{{message}}
{{linkLabel}}




